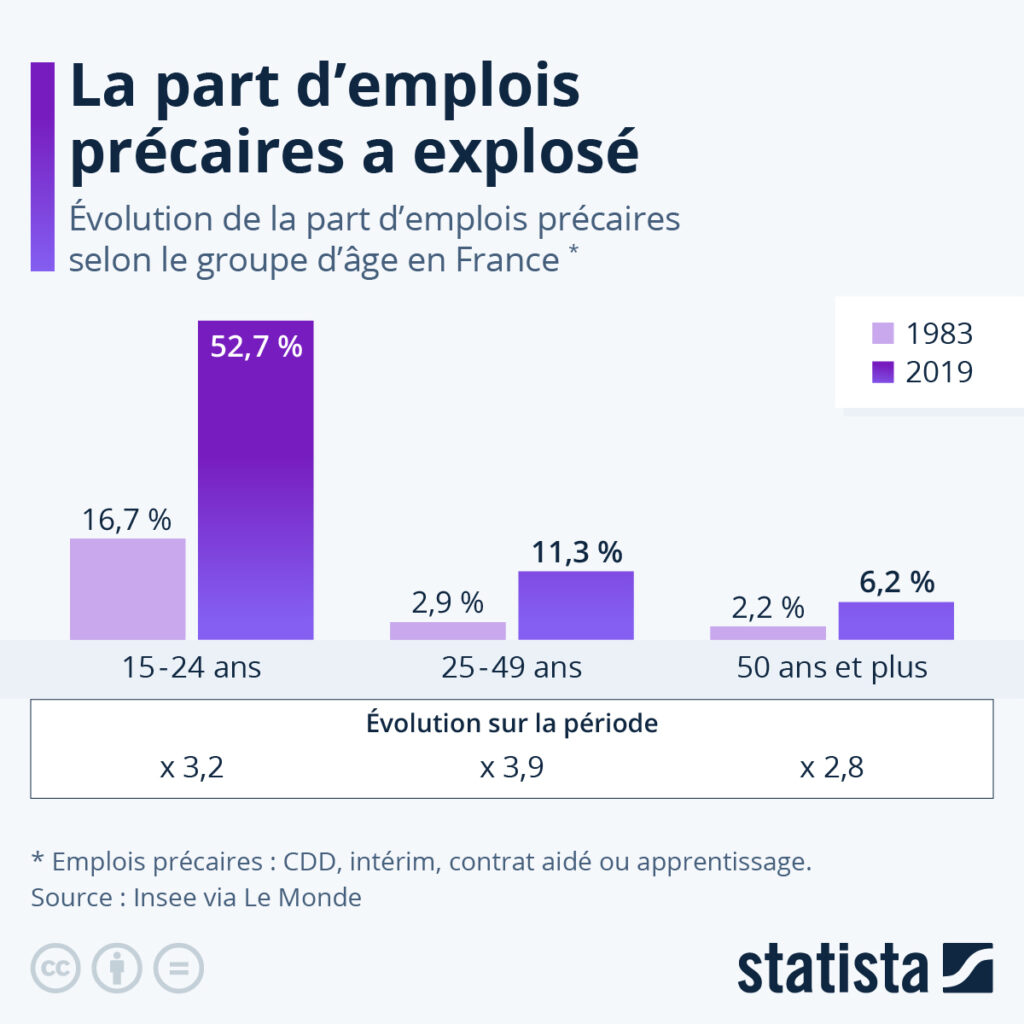Dans le Vaucluse, 80% des salariés restent optimistes sur leur avenir professionnel. Malgré cet état plutôt positif, le bilan de l’impact du travail sur la santé des salariés est mitigé. Pour 33%, le travail a un impact négatif sur leur santé physique et pour 28%, sur leur santé mentale. 38% se sont sentis trop stressés et sur le point de craquer au cours des derniers mois. Plus de la moitié des salariés souhaitent ralentir leur rythme de travail (53%). C’est, en substance ce que retient de 2024 l’Observatoire d’Harmonie mutuelle sur l’état d’esprit et les attentes des salariés en Provence-Alpes-Côte d’Azur, par l’organisme de sondage Lead opinion et sur un échantillon de 755 personnes.
«Parmi les éléments marquants, l’observatoire révèle que les salariés sont en quête de sens et souhaitent vivre une expérience professionnelle sur mesure, adaptée à leurs attentes, besoins et aspirations en fonction des problématiques métier, analyse Robert Jimenez, directeur régional Paca chez harmonie Mutuelle. En chiffres, près d’un salarié sur deux remet en question son poste actuel et considère que son travail a de moins en moins de sens.»
Les moins de 25 ans souhaitent donner du sens à ce qu’ils vivent au travail
«Une tendance qui s’accentue chez les moins de 25 ans à hauteur de 66% des personnes consultées. En parallèle, d’autres indicateurs démontrent que le travail a un réel impact sur la santé physique et mentale. Finalement, le fait que la relation avec la ligne hiérarchique représente le 3e facteur de stress chez les salariés démontre que les managers représentent un réel pivot dans les entreprises qui influe sur l’engagement des salariés.»
Quels moyens pour réduire le stress en entreprise ?
«Plusieurs axes peuvent être explorés comme l’approche managériale des 3R : Remercier, Revaloriser et Récompenser – est un excellent point de départ pour instaurer une culture de reconnaissance et de la bienveillance. L’activité physique, et le sport en particulier, comme la course à pied, la natation et le vélo…, jouent également un rôle crucial dans la gestion du stress.»

Mise en place d’initiatives variées
«Les entreprises peuvent mettre en place des initiatives variées, telles que l’organisation de cours pendant les heures de travail, ce qui en facilite l’accès et fédère les équipes. Cette pratique a un impact significatif : le sport réduit de 30% les dépressions liées au travail et diminue le stress et l’anxiété. Bien que plus facile à mettre en œuvre dans les grandes entreprises, des solutions existent aussi pour les plus petites, comme la participation à des abonnements à des activités en dehors du travail.»
Des attentes fortes
Les salariés émettent de fortes attentes fortes en matière de santé physique et mentale. Le travail a, ainsi, un impact négatif sur la santé physique pour 34 % des salariés et sur leur santé morale pour 35 % des salariés. Les principaux facteurs de stress des salariés cités sont tout d’abord la charge de travail ; La pression sur délais ; La relation avec la ligne hiérarchique ; Enfin, près de 58 % seulement considèrent que leur entreprise y est attentive.
Améliorer la santé des salariés
Parmi les actions évoquées pour améliorer la santé des salariés, l’amélioration des conditions de travail, à hauteur de 54 %, arrive en tête devant des actions liées au bien-être (40 %), au management (38 %), les actions de prévention des risques professionnels (24 %), l’encouragement à la pratique d’une activité physique (22 %).
Les attentes en termes d’engagements & valeurs de l’entreprise
Près de 86 % des salariés considèrent important que leur entreprise et les parties prenantes soient engagées pour un impact environnemental positif. 71 % pensent que leur entreprise a un impact environnemental positif. 80 % se sentent acteurs dans cette démarche. Et pourtant, 44 % considèrent que leur travail a de moins en moins de sens.
Les leviers d’engagement des salariés
La rémunération est le 1er facteur d’engagement cité (31 %), suivi par l’autonomie dans le travail (31 %), l’équipe (24 %), et la flexibilité des horaires (18 %). Parmi les salariés engagés, 79 % considèrent que leur manager joue un rôle déterminant dans leur engagement.
En quête d’un meilleur équilibre vie pro – vie perso
Plus de 4 salariés sur 5 sont satisfaits de leur équilibre vie professionnelle – vie personnelle en y apportant toutefois quelques changements : 55 % des personnes interrogées souhaitent ralentir leur rythme de travail et 70 % seraient prêts à mettre leur travail en second plan pour privilégier leur vie personnelle. Près d’un salarié sur 2 a remis en question son poste actuel, une proportion plus accentuée dans la catégorie socio-professionnelle des employés (54 %), des moins de 25 ans (66 %) et des célibataires avec enfants à charge (54 %). Plus d’un tiers des salariés souahitant quitter leur organisation le ferait immédiatement ou à court terme (moins de 6 mois), notamment les ouvriers, les collaborateurs de TPE (très petites entreprises) et les 25-34 ans.

CPME 13 , ouverture d’une Commission Santé du dirigeant dans les Bouches du Rhône
La Confédération des Petites et Moyennes entreprises a décidé de l’ouverture d’une Commission Santé du dirigeant.
«Le stress, le mal-être exprimés par 42% des sondés doit nous faire amplifier nos actions déjà engagées abonde Alain Gargani, Président de la CPME Sud. Les entrepreneurs, depuis plusieurs années déjà, ont pris conscience que la qualité de vie au travail était essentielle pour le bien-être des salariés. Le monde a changé et c’est notre rôle, en tant qu’organisation interprofessionnelle, d’accélérer cette mutation dans les entreprises, de prendre en compte la nouvelle vision que portent les salariés dans le travail. Il faut absolument s’adapter, mettre en place dans l’entreprise des moments de détente, davantage de flexibilité dans le travail, les horaires si on veut fidéliser nos collaborateurs afin que la qualité de vie s’améliore pour ainsi diminuer le stress et le mal-être.»
En savoir plus sur harmonie Mutuelle
Harmonie Mutuelle, entreprise à mission depuis 2021, accompagne les entreprises avec la complémentaire santé, la prévoyance, l’épargne retraite et la prévention. Avec près de 5 millions de personnes protégées, 88 700 entreprises clientes et 150 000 entrepreneurs accompagnés, Harmonie Mutuelle met le bien-être des salariés, au cœur de son travail pour favoriser l’attractivité et la performance des entreprises. Avec son modèle redistributif (80 % des cotisations redistribuées en prestations), sa gouvernance partagée, la mutuelle confirme son ancrage territorial en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 9 agences réparties dans 6 départements et organise de nombreux évènements (agoras mutualistes, ateliers de sensibilisation) au profit de ses adhérents et du grand public.