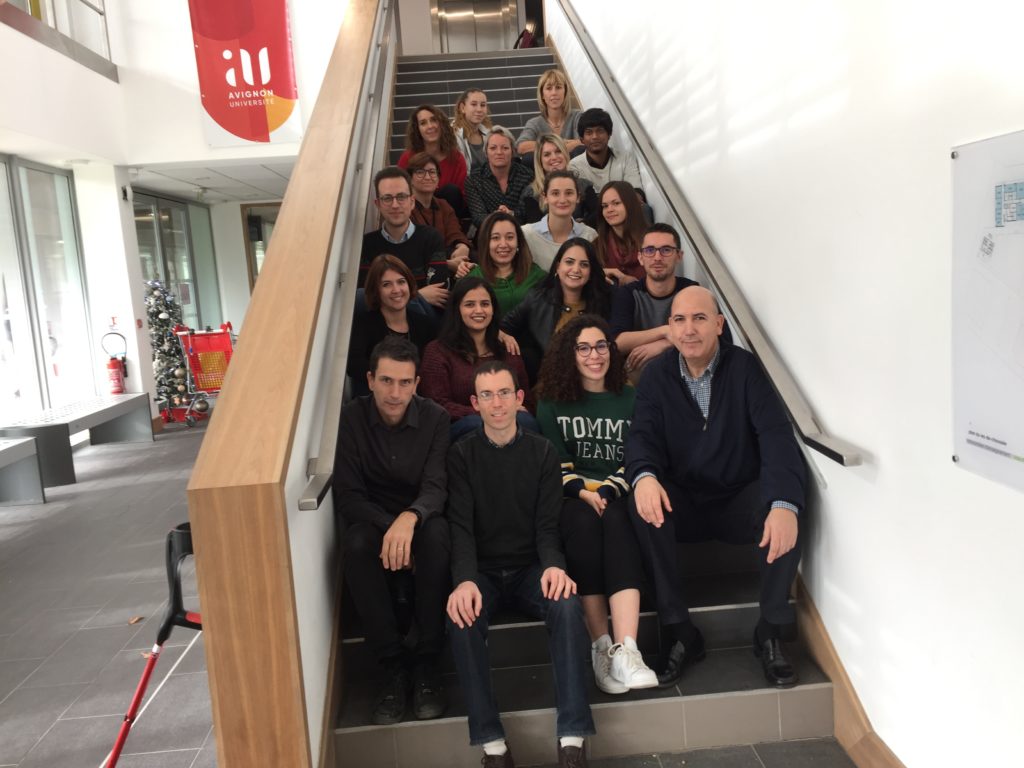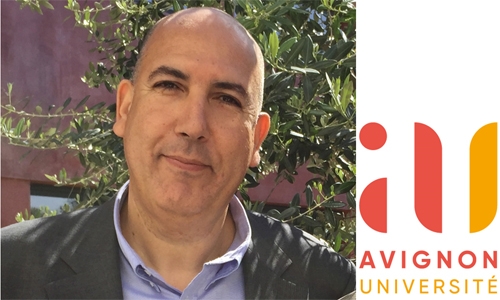A l’issue d’une banale chute à vélo à 17 ans, le jeune Paul Darbier devient tétraplégique. Un an après, sa famille ne cesse de multiplier les actions régionales et nationales auprès de célébrités de tout horizon.
« Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que je vais me remettre debout », des mots qui résonnent encore dans l’esprit de Caroline Darbier, originaire des Angles. L’association ‘Vertical combat’ poursuit une noble cause : sensibiliser le plus grand nombre et soulever des questionnements sur la prise en charge en France. Accident de voiture, plongeon en eau peu profonde, chute de ski, de VTT, ils sont plus de 1 200 chaque année à grossir les rangs des personnes victimes d’une malheureuse chute dont personne n’est à l’abri. Avant même son accident de VTT, Paul Darbier est un miraculé. Né avec une malformation cardiaque qui lui donnait une espérance de vie de 2 ans, le jeune Anglois est opéré à cœur ouvert à l’âge de 4 mois. « C’est sans doute pour ça qu’il s’est tourné vers le sport très tôt, il en faisait tous les jours », explique sa mère.
Banale chute à vélo
Paul a 17 ans. En avril 2020, période de confinement, le jeune passionné de sport tourne comme un lion en cage. Un besoin viscéral de prendre l’air le conduit dans la garrigue à proximité de chez lui, avec son vélo. Une activité somme toute banale pour un jeune de son âge fourmillant d’énergie, mais qui malheureusement connaitra une issue redoutable. La roue butte contre une motte de terre, le VTT se balance vers l’avant projetant vigoureusement le jeune Paul au sol.
« Il est tombé sur la tête, le casque de protection n’a pas protégé la nuque qui a donc supporté tout le poids du corps », nous confie sa maman qui a vu les images de l’accident tournées par l’ami de son fils. Très vite, Paul est hélitreuillé au CHU de Montpellier, parfaitement conscient, mais dans l’incapacité de ressentir la moindre sensation. Le verdict est sans appel, la chute a entrainé la lésion de la moelle épinière au niveau des cervicales, à l’origine d’une paralysie des 4 membres. Paul est tétraplégique.
Une succession de ‘montagnes‘
Placé en coma artificiel durant quelques semaines, le réveil est « abyssal ». Paul est dans sa chambre de réanimation avec une trachéotomie, un accès direct à la trachée envoyant l’air dans les poumons. Il ne peut ni bouger, ni manger, et ne parlera pas pendant 6 mois. « La douleur était atroce, il a fallu le mettre sous morphine », se remémore sa mère. On lui dit que sa vie désormais ce sera ça, qu’il devra apprendre à se servir de son menton.
Caroline et son époux découvrent alors un monde dont ils ignoraient tout. « Il a fallu franchir une succession de montagnes. Il y a d’abord le drame que l’on vit au moment de l’accident, et puis la bataille colossale qui s’en suit. On doit lutter contre l’administration, expliquer aux gens notre réalité, entreprendre des démarches, se faire entendre, trouver un établissement d’accueil, liste-t-elle. On a finalement été contraint de l’amener en Espagne où on lui a retiré la trachéotomie aussitôt. » Le seul institut qui répond est à Barcelone, l’Institut Guttmann. C’est dans ce centre spécialisé en rééducation fonctionnelle que Paul a pu bénéficier d’une méthode de soins plus actifs (5h de kinésithérapie par jour) et tournés vers la récupération de fonctions perdues.

« Je ne veux pas de cette vie »
Deux solutions s’offrent à la famille, « soit on s’effondre, soit on devient acteur et on transforme notre épreuve en quelque chose de positif. On en a fait notre cheval de bataille. C’est un drame, certes. Mais cet accident servira à tous les jeunes qui, inconscients, font par exemple des plongeons dangereux au Pont du Gard ou sont victimes d’autres chutes dramatiques. C’est une réalité aujourd’hui, je suis en relation avec plusieurs jeunes dans la même situation que mon fils. »
Très vite, Paul fait preuve d’un courage et d’une maturité remarquable. Quelque chose lui dit que la vie n’est pas un cadeau, qu’il faut la mériter, se battre. « Je suis persuadé que ça m’est arrivé pour quelque chose », confie-t-il un jour à sa mère. Les parents tiennent à le rassurer, il est ce qu’il est, debout ou assis, ça ne change rien. Un raisonnement que Paul rejettera aussitôt avec ardeur. Le jeune homme de 18 ans a la vie devant lui, il ne veut pas de ce quotidien et tient fermement à se battre jusqu’au bout. Preuve en est avec son fauteuil roulant manuel. « C’est important de faire comprendre qu’une personne avec l’envie de se battre a le droit de se battre, souligne madame Darbier. On ne peut pas imposer à un jeune de 18 ans de rester enfermé et de bouger son fauteuil avec son menton pour le diriger. »
Aujourd’hui, Paul poursuit son courageux chemin dans un centre près de Gap, dont les pratiques sont dans la lignée de celles en Espagne. « Ils sont supers, à l’écoute, dynamiques et ont compris les enjeux et la philosophie de Paul », se réjouit-elle. Ce dernier continue à travailler de manière acharnée ses membres et ses muscles pour ne pas perdre. « Quand on ne fait plus d’exercices, les tendons se rétractent, le muscle s’atrophie, les calcifications se forment. Il est primordial de maintenir le travail sur le corps pour qu’il soit prêt le jour ou la médecine apportera des solutions », explique sa maman.
Faire évoluer la prise en charge en France
Comment faire avancer la prise en charge en France pour que ne soit plus proposé que l’acceptation du handicap mais une voie vers des techniques de guérison ? Voilà le moteur de l’association ‘Vertical combat’ aujourd’hui. « Un spécialiste m’a conseillé de ‘respecter le sommeil neurologique’. Sauf qu’à force, tout le corps s’endort, alerte-t-elle. Les centres en France sont des centres d’adaptation au handicap, tournés davantage vers l’acceptation. Mais l’espoir est permis, notamment grâce aux essais clinique. »
Caroline nous fait part d’une anecdote, « un jeune dans le même cas que mon fils est parti en Pologne dans un centre avancé. A son arrivée, les spécialistes pensaient qu’aucune rééducation n’avait eu lieu alors que le jeune avait déjà fait 7 mois en France… Des patients français partent se faire opérer en Chine, donnant lieu à des récupérations étonnantes. » Toutefois, Caroline ne souhaite pas tomber dans la généralité, de nombreux chirurgiens Français prennent conscience du chemin à parcourir et s’ouvrent sur les techniques pratiquées ailleurs.
Courrier de Brigitte Macron
La mobilisation prend une telle ampleur que la première dame adresse un jour un courrier à Caroline. Brigitte Macron, Sophie Cluzel, alors chargée des Personnes handicapées et le ministre de la Recherche, y souligneront l’importance accordée par le gouvernement à l’aide aux famille. « C’est très sympa, mais nous sommes toujours en attente du remboursement par la sécurité sociale des frais d’hospitalisation qui s’élèvent à 183.600€, s’impatiente-t-elle. Je suis disposée à en discuter avec le gouvernement, à ouvrir le débat, mais la réalité des familles est tout autre. La logique de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) n’est pas toujours pertinente, notamment sur l’étude des besoins lorsque la personne rentre chez elle. Il y a quelque chose à faire, c’est étonnant que la France n’avance pas. » Le courrier informait la famille qu’elle serait contactée prochainement, aucun coup de fil depuis.
Et d’ajouter : « l’Etat français subventionne des organismes de recherche publique en orientant les investigations sur les nouvelles technologies tournées sur l’inclusion. Elles ne sont malheureusement pas orientées vers la guérison des lésions médullaires post-traumatiques. A ce jour, les essais cliniques indépendants ont été promus par des organismes de bienfaisance de la recherche et des groupes de volontaires comme les associations de patients. Cette situation explique le temps nécessaire pour récolter les fonds utiles à faire avancer la recherche. »
« Il faut un accompagnement immédiat »
Au Portugal, en Espagne, en Italie, en Suisse, les centres de récupération existent : il s’agit de positionner le patient dans une dynamique de travail intensif. Toutes les études en cours démontrent que c’est ce travail intensif qui permet de retrouver une mobilité et la récupération de fonctions perdues. Un travail intensif consiste à stimuler le patient plus de 5h tous les jours. « Un traitement, quel qu’il soit, nécessite une rééducation fonctionnelle importante : sans elle, les fibres nerveuses et axones ne peuvent repousser. Un tel centre n’existe pas en France à ce jour, déplore-t-elle. Les patients qui souhaitent avancer se tournent alors vers l’étranger pour trouver des solutions plus actives. La création d’un tel centre en France est un enjeu majeur que nous souhaitons encourager par nos actions. »
Pour Caroline et son époux, l’accompagnement fait défaut. « Quand son enfant est en réanimation, on se sent très seul. Un détail tout bête, comment étais-je censée communiquer avec mon enfant pendant 6 mois avec sa trachéotomie ?, interroge-t-elle. L’aide aux familles, ce n’est pas juste sur le papier, il faut un accompagnement réel et tout de suite après l’accident. Ce sont des choses à mettre en place avec les familles concernées, directement confrontées au problème. »
Les tennis de Tsonga
Pour soutenir l’association Vertical combat lancée par l’entourage proche de Caroline, le centre commercial Aushopping Avignon nord a mis en place une opération de solidarité : 1like = 1 euro. L’objectif des 1000 euros a très vite été dépassé avec un compteur affichant désormais 1500 likes. Aushopping remettra un chèque de 1000€ le 23 septembre à l’association. La sœur de Paul, Marie, a également relevé ses manches pour réaliser une tombola dans son lycée. Résultat ? 7 000€ récoltés.
La prochaine action ? Une grande soirée caritative au sein de la Maison Bronzini le 30 septembre. 10% du chiffre d’affaires sera reversé à l’association, mais également une tombola et des dons directs seront mis en place. « Il y a beaucoup d’initiatives dans la région car les gens sont touchés, c’est un jeune gardois victime d’une banale chute à vélo qui peut arriver à tout le monde », explique Caroline Darbier.
Une vente aux enchères aura également lieu en novembre. Des artistes et sculpteurs offriront des tableaux, le Conseil départemental de Vaucluse, par le biais de sa présidente Dominique Santoni, offrira le maillot dédicacé de Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France 2020 et 2021. « J’ai également rencontré Mathias Bourgue, un talentueux tennisman devenu le parrain de l’association, nous compte Caroline Darbier. Il est engagé aux côtés de Paul avec force et bienveillance. Il a permis de récolter des t-shirts, des ballons, des casquettes de sportifs professionnels, etc. On aura par exemple les tennis de Tsonga lors de la vente aux enchères. »

D’Omar Sy à Michel Drucker
Sportifs, acteurs, chanteurs, présentateurs tv, de nombreuses personnalités ont déjà soutenu Paul par un message vidéo : Dave, Edouard Baer, Mathias Bourgue, Michel Drucker, Sébastien Chabal, Charlotte Consorti, Gérard Darmon, Martin Fourcade, Grand Corps Malade Officiel, Mike Horn, Luka Karabatic, Omar Sy, et tellement d’autres.

« J’ai rencontré le skieur Edgar Grospiron lors d’une rencontre entrepreneuriale. Je me suis dit que finalement, pour devenir champion du monde, il fallait dépasser ses peurs, ses moments de doute, de désespoir, il y a un pont à faire avec les difficultés que Paul rencontre, explique-t-elle. Même si selon Edgard, ses montagnes sont infiniment plus hautes pour mon fils, il a tenu à jouer le jeu. Il a contacté des sportifs de haut niveau qui ont envoyé des vidéos d’encouragement de quelques minutes. Ils n’ont pas idée à quel point ces messages ont fait du bien à mon fils dans sa chambre d’hôpital. »
Caroline a également été en contact avec le skieur Kevin Rolland, médaillé de bronze olympique en half-pipe à Sotchi en 2014 et champion du monde de half-pipe en 2009. Suite à une mauvaise chute en 2019, le pronostic vital est engagé, le sportif frôle la mort et reviendra de très loin. Son message à Paul ? « Même lorsque tu es au plus bas, il y a toujours quelque chose de positif. Il faut que t’y accroches, de toutes tes forces. » Kevin Rolland a aujourd’hui repris la compétition.
Toutes les informations : www.verticalcombat.fr. Faire un don, cliquez ici. Après votre don, l’organisme vous fera parvenir un reçu fiscal. Si vous êtes imposable, il vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% du montant de votre don.