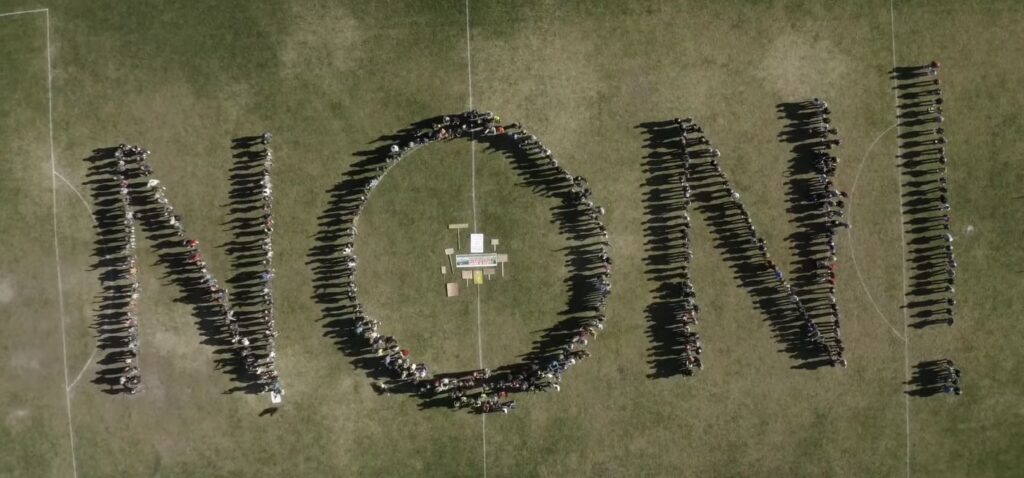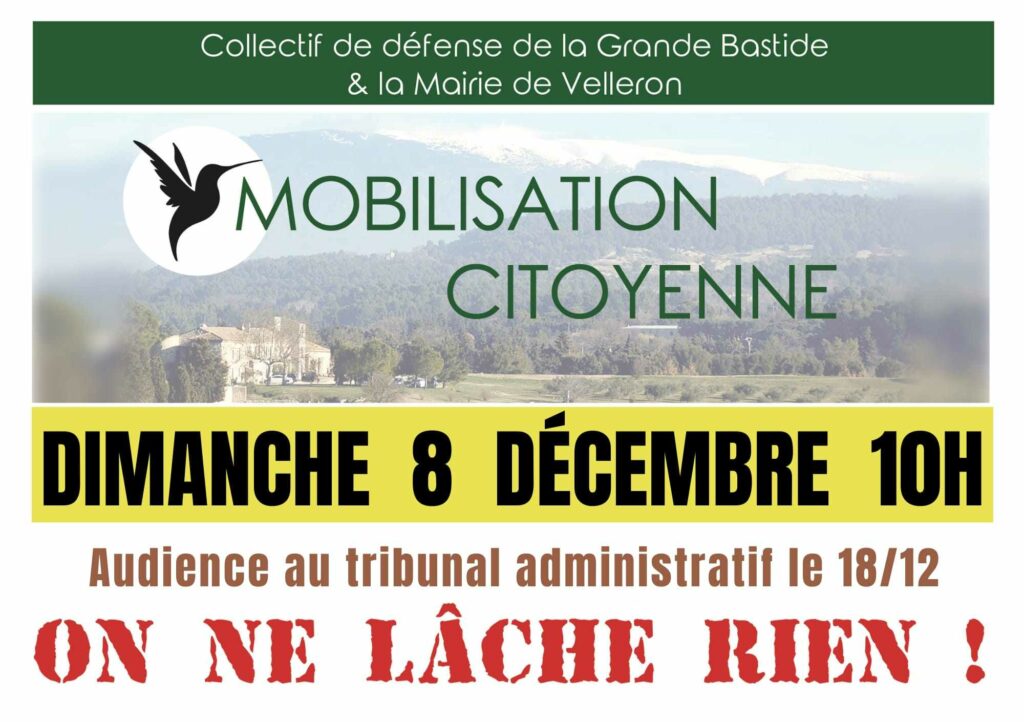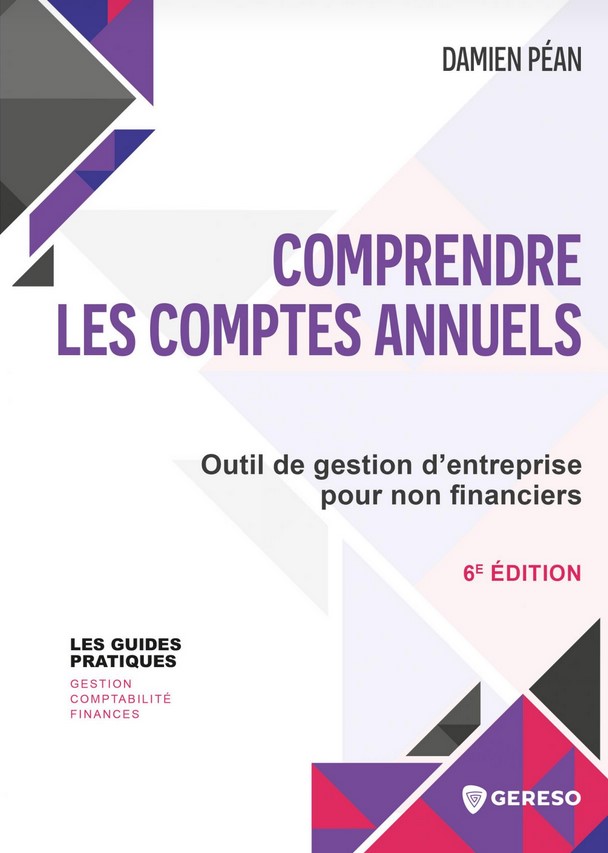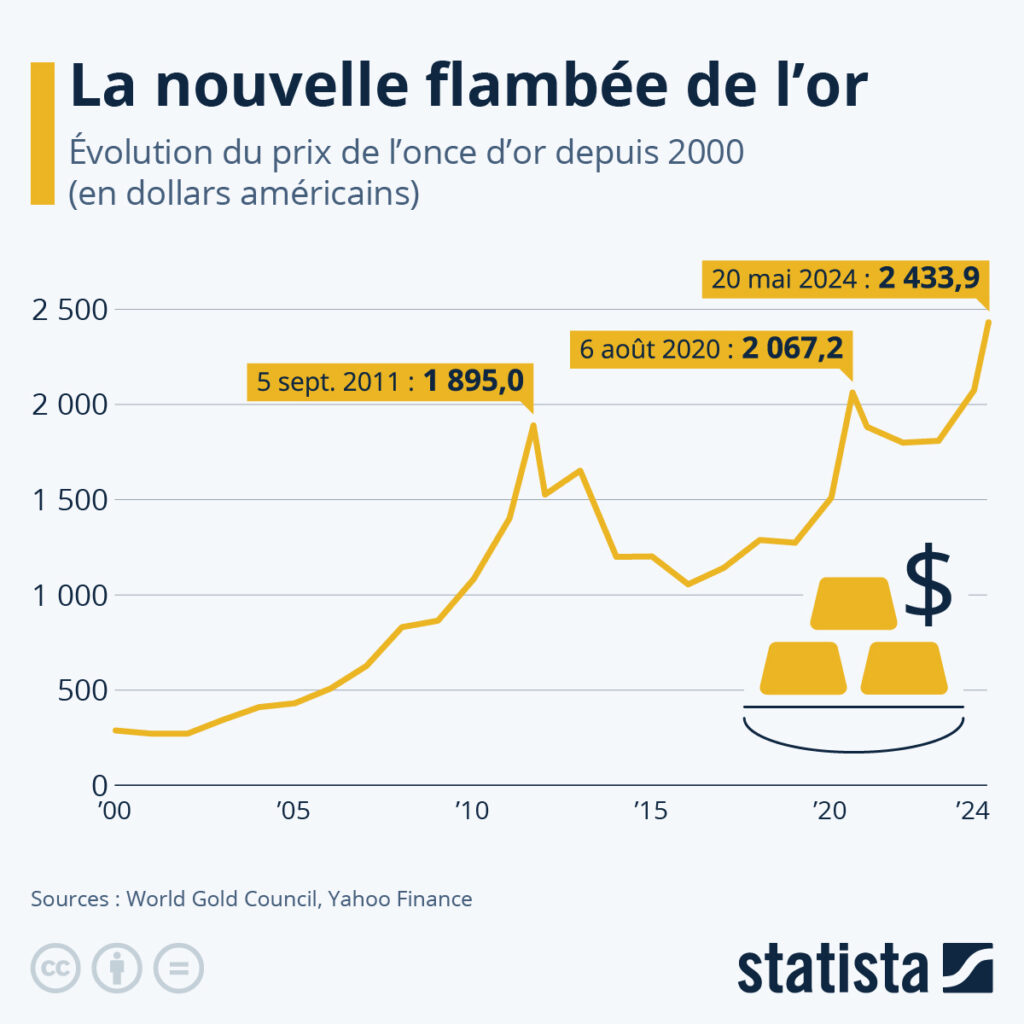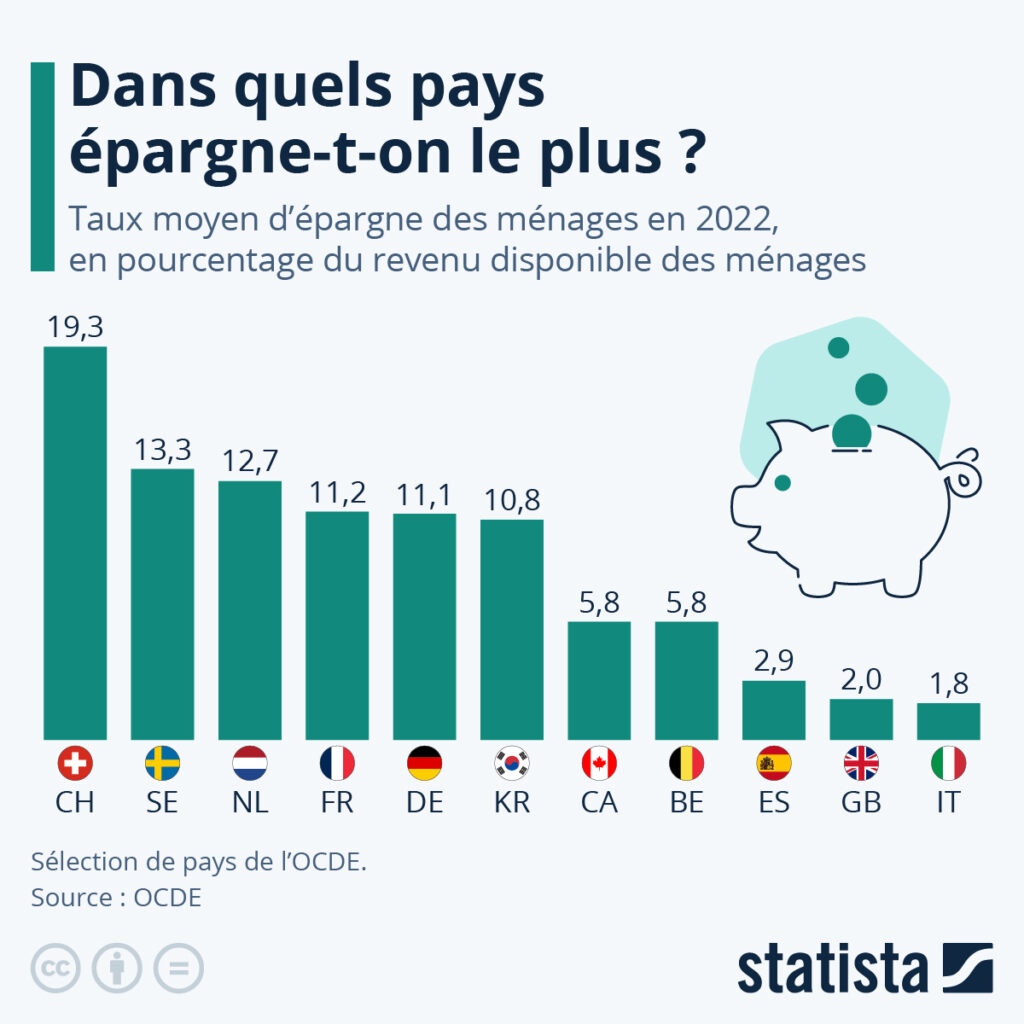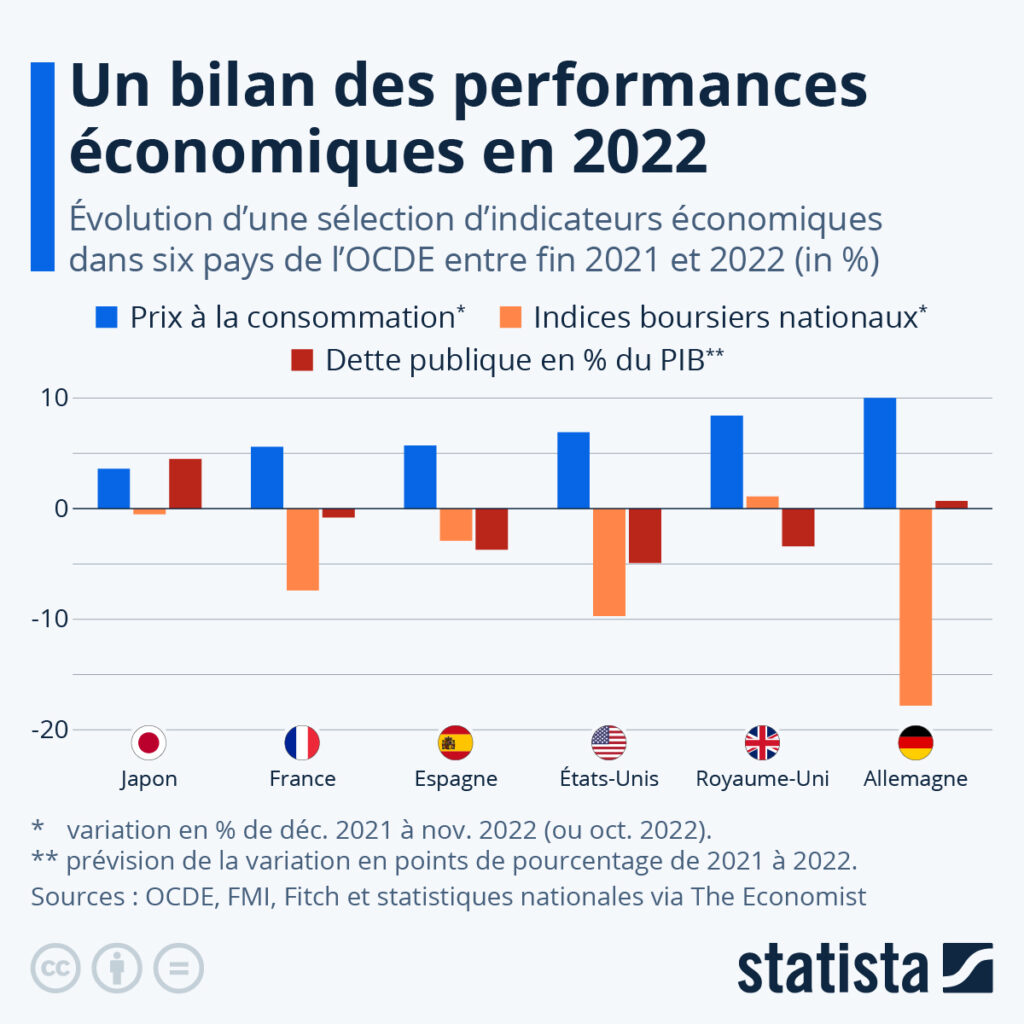Comment faire pour que, dans un couple, la gestion des revenus et dépenses ne soit pas un objet de discorde ? En 2010 selon l’Insee, 2/3 des Français mariés, pacsés ou en concubinage partageaient toutes leurs ressources sur un compte joint. Aujourd’hui, est-il vraiment nécessaire d’utiliser un compte joint ou, au contraire, faut-il fonctionner avec des comptes personnels ? MoneyVox apporte quelques éléments de réponses avec un sondage exclusif de YouGov* sur la gestion du compte joint au sein des couples.
La gestion du compte joint au sein des couples
Selon l’étude YouGov pour MoneyVox, 59% des sondés déclarent aujourd’hui détenir un compte joint avec leur partenaire, dont pas moins de 53% d’entre eux optent pour une mise en commun de tous leurs revenus sur ce compte. A l’inverse, 43% conjuguent une mise en commun partielle des ressources avec une certaine autonomie financière.
Cette mise en commun n’empêche pas une gestion du compte joint plutôt saine, puisque 77% des répondants déclarent consulter leur partenaire avant de réaliser des dépenses.
À noter tout de même que 39% des répondants en couple déclarent détenir uniquement un compte personnel à leur nom.
Le compte joint, des inconvénients ?
Lorsqu’un couple ne possède qu’un compte joint (et pas de comptes personnels), les co-titulaires ont évidemment connaissance de tous les mouvements du compte. Pas évident dès lors de préserver la surprise d’un cadeau de Noël, d’anniversaire ou de Saint-Valentin lorsque l’enseigne où l’on a fait des emplettes apparaît sur le relevé de compte, avec la somme exacte dépensée.
Au-delà de cet inconvénient autour de la confidentialité des dépenses, le compte joint comporte surtout des risques. En effet, en souscrivant ce type de produit auprès de la banque, les deux titulaires sont solidairement responsables de la vie du compte… et des dettes. En cas de solde négatif, ils doivent régler les frais de découvert à leur banque de façon commune.
« En effet, en cas de rejet de chèque sans provision par la banque, ce sont les deux co-titulaires (et pas seulement celui qui a rédigé le chèque litigieux) qui se retrouvent interdits bancaires et ne peuvent plus émettre de chèques, que ce soit depuis le compte joint ou depuis un compte personnel. En bref, avec cette solidarité sur les dettes, si l’un des membres du couple flambe ou réalise des dépenses qui ne sont pas dans l’intérêt de la famille, l’autre en est co-responsable ! », explique Maxime Chipoy, président de MoneyVox.
« Avant de partager une carte sur un compte joint, réfléchissez bien à 2 fois. »
Maxime Chipoy, président de MoneyVox
Partager la carte bancaire d’un compte joint, un risque ?
Pour faire des économies sur les frais bancaires, certains couples optent pour un compte joint et une carte pour deux… On peut d’ailleurs observer que 39% des répondants ont une carte bancaire pour un compte joint. Mais cette pratique est en réalité interdite et risquée.
A l’inverse du chéquier, où deux noms peuvent être indiqués, une carte bancaire est nominative et strictement personnelle. Seule la ou le titulaire, dont le nom est inscrit sur le moyen de paiement et qui y a apposé sa signature peut l’utiliser pour payer.
De ce fait, le partage de carte bancaire est prohibé, y compris au sein du couple. Il suppose de transférer la responsabilité de la carte à un tiers et de lui communiquer le code secret. Et il est important de noter plusieurs risques. Cela peut-être le refus de paiement ou alors une exposition à des refus de remboursement en cas de fraude.
« Bilan : avant de partager une carte sur un compte joint, réfléchissez bien à 2 fois. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Pas forcément, d’autant plus la 2e carte sur un même compte est généralement proposée à un prix nettement inférieur à la première (souvent 30 à 50% moins cher) », rappelle Maxime Chipoy.
*Enquête réalisée sur 2020 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 03 au 07 janvier 2025.