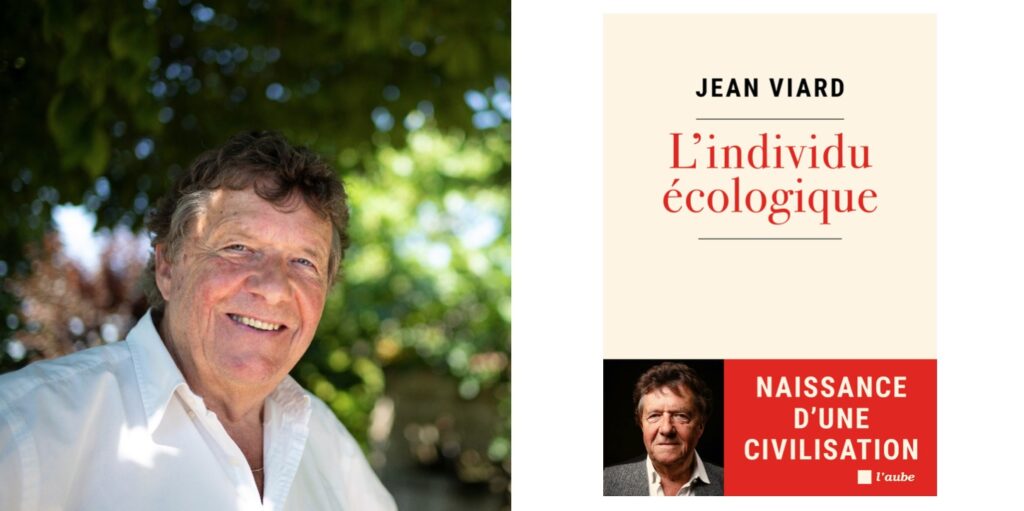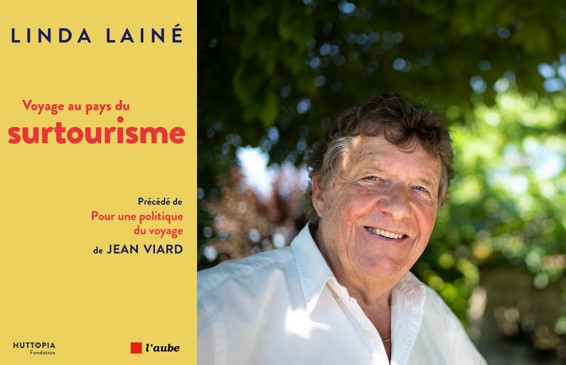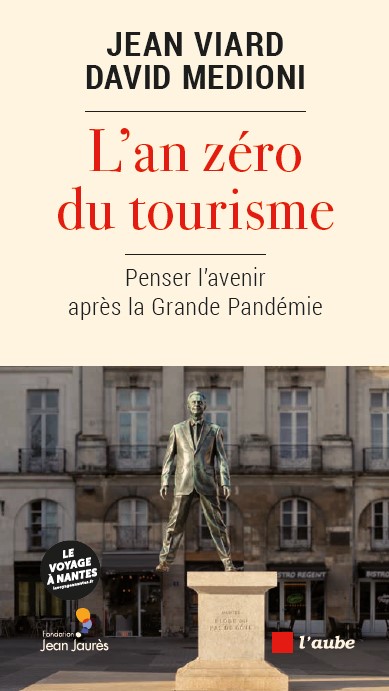Le mot figure dès 1993 dans une tribune du Vauclusien Jean Viard publiée dans Libération. Il l’appelait alors « La société d’archipel » et la définissait comme une figure qui cernait l’évolution de nos territoires individuels. Et trente ans plus tard, le sociologue revient sur la réflexion qu’il a prolongée avec ce livre-somme. Il fait le point en 445 pages sur les métamorphoses de notre société ces dernières décennies, la place de chacun, son interaction avec l’autre, passant de la ligne Maginot à la Chute du Mur de Berlin puis au mur érigé entre les États-Unis et le Mexique.
Un chapitre est dédié à la Provence, « Pays entre la mer Méditerranée et le massif alpin… C’est l’axe Nice / Marseille / Avignon, celui des capitales actuelles du pouvoir d’Etat, celui des TGV et des autoroutes. Un principe double, de mer et de montagne. » Les calanques côtières de Marseille, restée ville grecque d’un côté, de l’autre Aix-en-Provence, siège de l’Évêché, du Parlement, ville de la rente terrienne, de notaires et de juristes. L’aristocratique et la populaire à moins de 30 km de distance. L’une a dominé et géré la côte, la mer, le commerce, les croisières, la seconde l’intérieur, Cadarache et Iter.
Jean Viard zoome ensuite sur « Le Vaucluse », limité par la Durance au Sud et le Rhône à l’Ouest. « Quand la Révolution invente les départements, il n’y a pas de Vaucluse. » Les Pays du Luberon sont dans les Bouches-du-Rhône, le Nord du département dans la Drôme et le Comtat Venaissin encore au Pape. Quand le rattachement à la France est proclamé, le Vaucluse est dessiné autour du Comtat, Pertuis lorgne déjà vers Aix. Puis le pouvoir central est déplacé de Carpentras vers Avignon. Et le flux économique est drainé par le Rhône « où remontent sur Paris les fruits et légumes des maraîchers, les vins des vignerons. Là sont les grands marchés agricoles, Cavaillon, Châteaurenard. » Puis les MIN de Carpentras et d’Avignon.
Il évoque ensuite un nouvel ordre du temps où vitesse et santé ont boosté le mouvement de démocratisation du XXᵉ siècle avec « Logements chauffés, eau courante, bains, éclairage, stockage alimentaire, divertissements à domicile, études, moyens de transports. Avec l’électricité, la TV, les supermarchés, la poste, l’électroménager, l’information. » En 1900, la France comptait 3 000 véhicules (plutôt des diligences et des fiacres) et aujourd’hui 30 millions de voitures.
Jean Viard passe à ce fameux « Individu écologique » au milieu d’un monde d’une infinie diversité. « Comment lier la fragmentation en archipels de nos espaces-temps au sein d’une planète bornée, limitée et interactive ? Demande-t-il. Avons-nous une vision trop européenne ? Quelles réflexions communes entre un jeune Asiatique bousculé par un démarrage économique trop rapide ? Un Africain qui tente de se protéger du désespoir qui submerge son continent, du jeune Ukrainien qui ne sait pas encore s’il échappera à la guerre et une jeune des banlieues qui hésite entre le RSA et la dope ? Cela démontre justement ce qu’est un monde d’archipels. »
L’auteur habite dans le Vaucluse. « Entre deux cimetières, chacun distant de 20km, celui de Lourmarin où est enterré le Prix Nobel de littérature Albert Camus et celui de Manosque où repose Jean Giono. L’un est l’auteur de La Peste, l’autre du Hussard sur le toit qui se passe au temps du choléra. » Le grand confinement imposé pendant la pandémie a bouleversé nos vies, poursuit Jean Viard. « Je ne m’étais jamais servi de Zoom avant, ni de Skype. On est totalement immergés dans le chaudron numérique, Twitter a été inventé en 2007, Facebook organisé la même année et 38 millions de Français achètent par e-commerce. Huit milliards d’êtres humains ont vécu la même aventure de confinement. La pandémie a été un accélérateur de tendances, un lanceur d’alertes pour façonner un nouveau monde. »
Il poursuit : « Nous sommes face à un désir vital de radicalité : déménager, démissionner, se séparer, changer de métier, quitter son patron, voter pour des solutions extrêmes. Le CDI ne fait plus rêver. Deux ans après les Gilets Jaunes, le terrain demeure extrêmement glissant. Il va falloir apprendre à faire des compromis. Le journalisme inquisiteur ne remplace ni le travail d’enquête sur le terrain, ni la rigueur, ni la compétence. Passer en boucle des élus marginaux, des syndicalistes minoritaires et des citoyens protestataires ne représente par l’opinion, mais tente de la façonner et d’y mettre le feu », ajoute-t-il.
Jean Viard évoque alors un débat avec l’éthologue Boris Cyrulnik en juin dernier, au cœur du magnifique théâtre de Châteauvallon, à quelques encablures de Toulon, où, il y a une quarantaine d’années, l’historien Fernand Braudel avait longuement parlé de la civilisation méditerranéenne. Les deux hommes ont évoqué la baisse de la natalité. « Les femmes se sont libérées d’une domination grâce au travail, aux études où elles sont meilleures que les hommes et où les hommes se disent je n’ai plus besoin de faire tourner le foyer, bouillir la marmite. On voit se multiplier les décohabitations. Les jeunes filles issues de l’immigration sont au même niveau que les autres en deux générations, ce qui n’est pas le cas des garçons. Et le problème, c’est la natalité qui baisse, avec en prime peu, trop peu de crèches. A contrario, les pères d’aujourd’hui s’occupent davantage de leurs enfants et peuvent bénéficier d’un long congé parental. »
Jean Viard conclut : « Nous devons relier nos bribes d’appartenances, de genre, de culture, de religion, de nation, de continent pour nous rapprocher, nous rassembler. Mais pour y parvenir, voir plus loin que les brumes noires de l’actualité hystérisées par des réseaux numériques complotistes et manipulateurs, nous devons reprendre l’immense combat ‘pour faire humanité commune’, comme l’écrivait le philosophe sénégalais Souleymane Bachir-Diagne en 2016 ou comme l’a fait Nelson Mandela en construisant un pays post-apartheid ». Un double exemple porteur d’espoir pour ne pas nous emmurer chacun dans sa tour d’ivoire, son archipel.
Référence : ‘L’individu écologique‘ de Jean Viard – L’Aube éditeur 26€