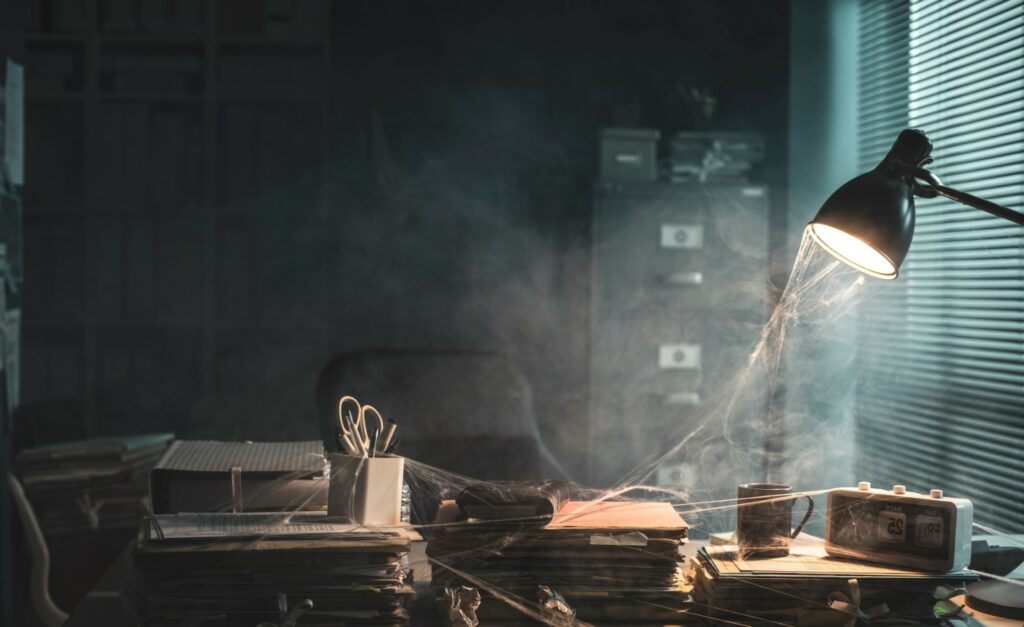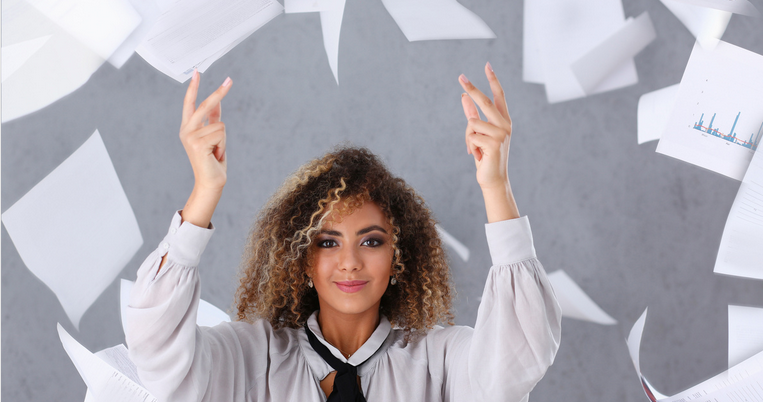Saisi notamment par des syndicats, le Conseil d’État rejette aujourd’hui la demande d’annulation du décret du 17 avril 2023 mettant en œuvre le dispositif de présomption de démission en cas d’abandon de poste, instauré par la loi dans le secteur privé. Le Conseil d’État précise toutefois que, pour que la démission d’un salarié puisse être présumée, ce dernier doit nécessairement être informé des conséquences que peut avoir l’absence de reprise du travail sans motif légitime.
La loi du 21 décembre 2022 a instauré un dispositif de présomption de démission du salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur. Les modalités d’application de cette nouvelle procédure ont été fixées par le décret du 17 avril 2023, qui s’est également accompagné d’une « foire aux questions » (FAQ) intitulée « Questions-réponses – Présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié », publiée le 18 avril 2023 sur le site internet du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion. Des syndicats ont saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation du décret et de la FAQ et le remplacement de cette dernière sur le site du ministère.
Le Conseil d’État relève tout d’abord que le décret attaqué se borne à fixer les modalités d’application de la loi et ne peut donc être regardé comme un « projet de réforme » qui aurait dû être soumis à une concertation préalable, comme le prévoient le Préambule de la Constitution de 1946 et le code du travail.
Les requérants reprochaient ensuite à la loi et au décret de ne pas avoir prévu de faire bénéficier le salarié des garanties prévues par la convention internationale du droit du travail n° 158 sur le licenciement. Cette convention ne couvre cependant que la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur et non les situations de démission volontaire. Elle n’est donc pas applicable car, si c’est bien l’employeur qui initie la procédure par l’envoi d’une mise en demeure, c’est en réalité le salarié, par son absence persistante sans justification, qui est à « l’initiative » de la rupture de la relation de travail.
Le Conseil d’État souligne par ailleurs que, comme le décret le rappelle, l’abandon de poste ne peut pas être considéré comme volontaire en cas de motif légitime, par exemple des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait ou du droit de grève, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à la réglementation, ou des modifications du contrat à l’initiative de l’employeur. La présomption de démission ne peut donc jouer dans ces situations.
En outre, cette loi prévoit l’envoi par l’employeur d’une mise en demeure au salarié qui a abandonné son poste. Cette mise en demeure a pour objet de s’assurer du caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié, en lui permettant de justifier son absence ou de reprendre le travail dans le délai fixé. S’agissant de l’abandon de poste dans la fonction publique, le Conseil d’État avait déjà jugé que, pour que la démission de l’employé puisse être présumée, ce dernier devait nécessairement être informé des conséquences que pouvait avoir l’absence de reprise du travail sans motif légitime. Dans la décision qu’il rend ce jour, le Conseil d’État adopte la même position pour les salariés du privé, même si le décret ne l’avait pas explicitement précisé.
Enfin, la loi prévoit que l’employeur doit envoyer la mise en demeure par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge. Le décret attaqué précise que le délai que l’employeur doit accorder au salarié pour justifier son absence ou reprendre le travail est d’au moins quinze jours à partir de la date de présentation de la mise en demeure. Le Conseil d’État estime que le décret fixe pour ce délai minimum une durée et un point de départ clairs, qui ne sont ni contraires à la loi ni manifestement erronés.
Plusieurs requérants avaient également demandé l’annulation de la « foire aux questions », mise en ligne sur le site internet du ministère le 18 avril 2023 et qui prenait position sur la possibilité pour l’employeur de choisir entre la procédure de l’abandon de poste et celle du licenciement pour faute. Ni la loi ni le décret ne comportent de dispositions sur ce point. Mais le Conseil d’État, constatant que cette partie de la FAQ avait été retirée du site en juin 2023 et que la nouvelle version mise en ligne ne reprenait pas les mentions contestées, ne s’est pas prononcé sur cette question.
Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État rejette les demandes d’annulation du décret du 17 avril 2023 et juge qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes liées à la FAQ « Questions-réponses – Présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié ».
Décision n°473640, 473680, 474392, 475097, 475100, 475194 du 18 décembre 2024